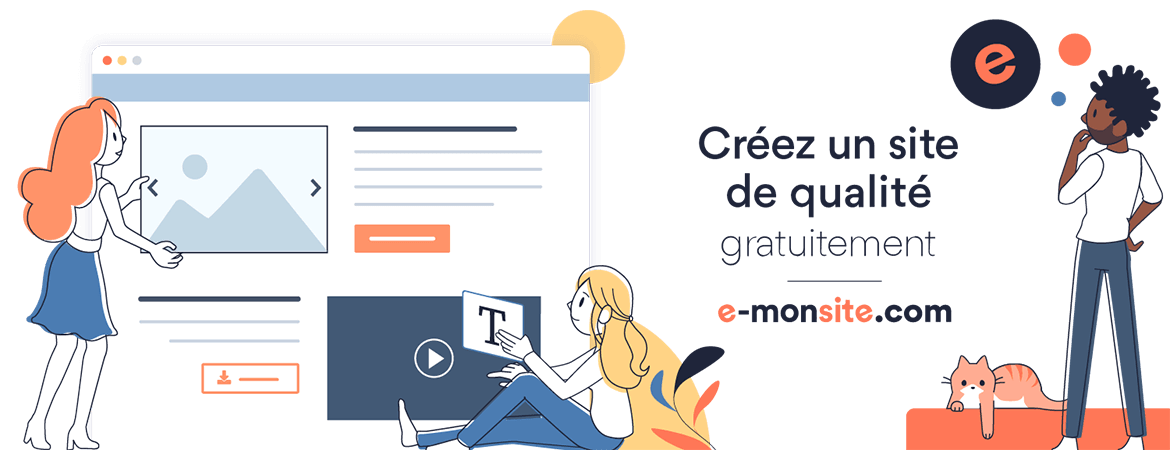Musset Acte III, scène 3
Le théâtre du XVIIe siècle au XIXe siècle
Parcours : Les jeux du cœur et de la parole
Alfred de Musset
On ne badine pas avec l’amour, Acte III, scène 3, 1834
Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
Parcours : Les jeux du cœur et de la parole
Alfred de Musset
On ne badine pas avec l’amour, Acte III, Scène 3, 1834
|
1
5
10
15
20 |
PERDICAN Regarde comme notre image a disparu ; la voilà qui revient peu à peu ; l’eau qui s’était troublée reprend son équilibre ; elle tremble encore ; de grands cercles noirs courent à sa surface ; patience, nous reparaissons ; déjà je distingue de nouveau tes bras enlacés dans les miens ; encore une minute, et il n’y aura plus une ride sur ton joli visage : regarde ! c’était une bague que m’avait donnée Camille. CAMILLE, à part. PERDICAN Sais-tu ce que c’est que l’amour, Rosette ? Écoute ! le vent se tait ; la pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. Par la lumière du ciel, par le soleil que voilà, je t’aime ! Tu veux bien de moi, n’est-ce pas ? On n’a pas flétri ta jeunesse ; on n’a pas infiltré dans ton sang vermeil les restes d’un sang affadi ? Tu ne veux pas te faire religieuse ; te voilà jeune et belle dans les bras d’un jeune homme. Ô Rosette, Rosette ! sais-tu ce que c’est que l’amour ? ROSETTE PERDICAN Oui, comme tu pourras ; et tu m’aimeras mieux, tout docteur que je suis et toute paysanne que tu es, que ces pâles statues fabriquées par les nonnes, qui ont la tête à la place du cœur, et qui sortent des cloîtres pour venir répandre dans la vie l’atmosphère humide de leurs cellules ; tu ne sais rien ; tu ne lirais pas dans un livre la prière que ta mère t’apprend, comme elle l’a apprise de sa mère ; tu ne comprends même pas le sens des paroles que tu répètes, quand tu t’agenouilles au pied de ton lit ; mais tu comprends bien que tu pries, et c’est tout ce qu’il faut à Dieu. ROSETTE PERDICAN Tu ne sais pas lire ; mais tu sais ce que disent ces bois et ces prairies, ces tièdes rivières, ces beaux champs couverts de moissons, toute cette nature splendide de jeunesse. Tu reconnais tous ces milliers de frères, et moi pour l’un d’entre eux ; lève-toi, tu seras ma femme et nous prendrons racine ensemble dans la sève du monde tout-puissant.
|
« J’ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui ». Cette phrase de Georges Sand a tellement marqué son amant Alfred de Musset qu’il l’a glissée dans la bouche de Perdican, le protagoniste de sa pièce de théâtre écrite en 1834 intitulée On ne badine pas avec l’amour. Cet auteur, dandy et romantique éclectique manie également la poésie dans son recueil Les Nuits et le roman dans Confession d’un enfant du siècle par exemple. A la fin de sa courte vie, il fait partie des immortels, c’est-à-dire qu’il est élu à l’Académie française. On ne badine pas avec l’amour commence comme une comédie sentimentale parfois satirique mais s’achève sur une note tragique, se rapprochant du drame Romantique. En effet, la règle classique des trois unités édictée par Boileau est renversée puisque l’intrigue ne se déroule pas dans un même lieu et évolue sur trois jours au lieu d’un. En revanche, une seule intrigue occupe le spectateur, dans une comédie proverbe qu’Alfred de Musset enrichit par sa liberté (notamment en abandonnant les alexandrins pour la prose). Il est un des rares dramaturges à offrir aux personnages féminins comme Camille de grands moments d’éloquence lyrique aux sonorités parfois autobiographiques. Comment l’auteur met-il en évidence les multiples jeux du cœur et de la parole dans cette troisième scène de l’acte III ? Dans un premier mouvement, de la première ligne à la ligne 12, nous nous intéresserons à la parole blessante de Perdican. Dans un second mouvement, de la ligne 13 à la fin du texte, nous nous questionnerons sur la valeur de la parole.
I/ La parole blessante destinée à Camille (lignes 1 à 12)
La parole de Perdican a, dans cette scène, plusieurs destinataires : Rosette, présente dans le bois avec lui. C’est une paysanne qu’il fait semblant d’aimer pour rendre jalouse Camille, qu’il aime sincèrement sans réussir à l’exprimer correctement et qui le repousse. Camille assiste à une mise en scène de Perdican qui sait qu’elle est présente et qui parle fort pour qu’elle l’entende. Le lecteur est le troisième interlocuteur du personnage par le jeu de la double énonciation théâtrale.
Dans sa première réplique, Perdican mobilise un vocabulaire typique du couple : le possessif (« notre », ligne 1) et le pronom personnel de la première personne du pluriel (« nous » ligne 3) ainsi que la posture classique des amants enlacés : « tes bras enlacés dans les miens » (ligne 3). La douceur de la déclaration d’amour semble omniprésente.
Cependant, le champ lexical de la vue indique que cet amour est feint, que la parole est fausse car les apparences sont trompeuses : « regarde » (lignes 1 et 4), « image » (l. 1), « distingue » (l. 3) et « joli » (l.4). Les amants, penchés au-dessus de la fontaine, contemplent leur image troublée par le geste indiqué par la didascalie « il jette sa bague dans l’eau ». Perdican a conscience d’être un acteur jouant un rôle pour Camille, il agit donc en metteur en scène avec Rosette : il lui explique ce qu’elle doit faire en utilisant des verbes à l’impératif : « regarde » (ll.1, 4), le présentatif « voilà » (l.1) et il commente ses gestes pour que Camille, cachée, comprenne ce qu’il fait : « c’était une bague que m’avait donnée Camille » (l. 4-5). Il insiste sur la fin de leur union puisque la bague symbolise le mariage et qu’il utilise deux verbes à l’imparfait (« c’était » et « m’avait » ligne 4). La parole de Perdican a pour but de blesser Camille, de lui signifier leur rupture sans qu’elle puisse répondre.
Symboliquement, en jetant sa bague dans l’eau, il fait ses adieux à Camille pour aimer Rosette. C’est aussi ce que semble indiquer la description de l’eau de la fontaine : comme Camille, elle est « troublée » (l. 1), elle « tremble » (l. 2). Une phrase semble annoncer la fin de la pièce, comme une pierre d’attente : « de grands cercles noirs courent à sa surface » (l. 2).
La réplique courte, faite en aparté, comme l’indique la didascalie, introduit une autre forme d’échange : Camille s’adresse au public à la ligne 6 : « il a jeté ma bague dans l’eau ».
A la ligne 7, Perdican commence une nouvelle tirade par une question qui semble rhétorique puisqu’il ne laisse pas la jeune femme lui répondre : « sais-tu ce que c’est que l’amour, Rosette ? ». Il enchaîne directement avec une nouvelle injonction : « écoute ! » est à l’impératif. Musset, en véritable Romantique, invite la nature dans sa pièce. « Le vent se tait » est une personnification pour mettre en scène le silence de la scène. « La pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime » (ll. 7-8) ressemble au vers d’un poème, convoquant une métaphore qui compare les gouttes de rosées à des perles. Les feuilles des arbres reprennent vie grâce au soleil. Le discours est celui du renouveau, comme Perdican souhaite vivre un nouvel amour avec Rosette. Ligne 8, il commence une phrase qui ressemble au début d’un serment « par la lumière du ciel, par le soleil que voilà » où le champ lexical de la nature se prolonge. Il déclare ensuite sa flamme : « je t’aime ! » dans une phrase exclamative qui semble exprimer ses sentiments. La Nature personnifiée, idéalisée répond à la quête de Perdican (et de Musset) d’un amour idéalisé, idyllique, inaccessible en réalité.
Il demande l’approbation de Rosette en la questionnant : « tu veux bien de moi, n’est-ce pas ? » (l. 9). Pour qu’elle acquiesce, il ajoute une série de négations qui décrivent en creux Camille et critiquent les religieuses qui l’ont élevée par l’utilisation du pronom impersonnel « on » (ll. 9 deux fois). Cette comparaison implicite entre Rosette et Camille s’effectue à l’aide d’antithèses « flétri » s’oppose à « jeunesse » (l. 9), « sang vermeil » à « sang affadi » (l.10). La série de trois questions rhétoriques s’achève et laisse place à une troisième négation totale. Les deux premières commencent par l’adverbe de négation « n’» et ajoutent le forclusif « pas » tandis que la troisième utilise « ne » et « pas » (l. 10). Perdican oppose complètement les deux sœurs de lait dans sa tirade et complimente Rosette de manière à peiner Camille en même temps. Le présentatif « voilà » revient (l. 10) pour évoquer la jeunesse et la beauté de Rosette et la replacer dans ses bras. La tirade s’achève sur une apostrophe de Rosette utilisant le vocatif « ô » et la répétition de son prénom en épizeuxe. Le lecteur se demande si Perdican ne répète pas ce nom pour oublier celui de Camille, au moins en apparence. La phrase et la tirade terminent par la répétition, comme un refrain, de la question initiale dans une forme de chiasme : « sais-tu ce que c’est que l’amour (A)/ Rosette (qu’il n’aime pas B, ligne 7), Rosette (B) / sais-tu ce que c’est que l’amour » (A, ligne 11).
Dans ce premier mouvement, la parole a plusieurs destinataires et plusieurs tonalités : elle est douce, éloquente pour Rosette mais elle est fausse puisque le lecteur sait que Perdican n’aime pas Rosette. Il joue avec ses sentiments en cherchant à la faire tomber amoureuse de lui. Il s’adresse en même temps méchamment à Camille, dont il cherche à blesser le cœur, par orgueil, parce qu’elle l’a heurté d’abord. La suite du texte nous invite à réfléchir à la valeur de la parole.
II/ La valeur de la parole remise en question (ligne 13 à la fin du texte)
Rosette répond à Perdican par une brève réplique expressive qui indique sa candeur et marque la différence de leurs statuts sociaux : elle l’appelle par la périphrase « monsieur le docteur » et le vouvoie (l. 12). Les verbes qu’elle utilise sont au futur, ce qui montre qu’elle se projette avec lui dans l’avenir mais que son amour n’existe pas encore au présent. L’interjection « hélas », l’exclamation et la fin de la phrase « comme je pourrai » sous-entendent que la jeune femme doute d’avoir les capacités d’exceller sur ce point alors que l’amour ne s’apprend pas, contrairement à la rhétorique.
Perdican reprend la parole dès la ligne 13 en acquiesçant et en répétant ses paroles : « oui, comme tu pourras » mais il surenchérit en continuant la comparaison péjorative avec Camille. Le discours condescendant « tout docteur que je suis et toute paysanne que tu es » (l. 13) met en fait en avant les qualités de Rosette : son ignorance et sa naïveté sont vues comme des qualités par une vision rousseauiste pour qui l’éducation dénature la bonté de l’humain. Il compare Camille, sans la nommer et en la confondant dans un groupe indéterminé « ces pâles statues fabriquées par les nonnes » (l. 14). Cette métaphore est triplement péjorative : la pâleur s’oppose à la couleur donc à la vie, le fait d’être une statue réifie la personne et le fait d’être fabriquée par les nonnes montre une absence totale de volonté traduite par la tournure de la phrase puisque les statues n’agissent pas mais sont objet dans cette phrase. La proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif « qui » ajoute une critique : « ont la tête à la place du cœur ». Elles sont si éduquées qu’elles ne savent plus aimer. Cette critique, aux yeux du lecteur, retombe par ricochet sur Perdican qui est dans la même situation. Elle est donc ironique dans sa bouche. La phrase termine par une métaphore étrange enchâssée dans une nouvelle proposition subordonnée relative introduite une fois de plus par le pronom qui : « et qui sortent des cloîtres pour venir répandre dans la vie l’atmosphère humide de leurs cellules » (l. 15). Elle fait ressembler Camille à une sorcière ou une sorte de fantôme.
Perdican se recentre sur Rosette « tu ne sais rien » (l. 15) montre qu’il la considère comme pure (et en creux qu’il rejette l’instruction de Camille). « Tu ne liras pas dans un livre la prière que ta mère t’apprend, comme elle l’a apprise de sa mère » (l. 16) montre une supériorité de la tradition orale et des intentions sur la compréhension. « Tu ne comprends même pas le sens des paroles que tu répètes, quand tu t’agenouille au pied de ton lit » (ll. 16-17) indique que les prières, apprises et répétées en latin, sont hermétiques à la compréhension du plus grand nombre sans empêcher le commun des mortels de prier sincèrement, ce qu’indique la conjonction de coordination d’opposition « mais tu comprends bien que tu pries ». Il ajoute que non seulement c’est cela qui lui plaît mais en outre cela plaît à Dieu (l. 18).
Rosette répond par une exclamation « comme vous me parlez, monseigneur ! ». On mesure toute la déférence qui l’anime et le trouble qui l’envahit sans doute. Curieuse déclaration d’amour que celle qui fait l’éloge de votre ignorance. Perdican ne la laisse pas continuer. Il reprend la parole sur un ton Romantique, en exaltant la Nature et en y opposant le savoir : « tu ne sais pas lire » s’oppose à « tu sais ce que disent ces bois et ces prairies » par la conjonction de coordination « mais ». Le champ lexical de la nature est omniprésent et accompagné d’adjectifs qualificatifs mélioratifs : « tièdes rivières », « beaux champs couverts de moissons », « nature splendide de jeunesse » (l. 20-21). Il place l’Homme à égalité avec les éléments naturels cités par le vocable de « frères » (l. 22), lui y compris « et moi pour l’un d’entre eux ». Il parle à sa place, explique à sa place sa vision des choses telle qu’il la suppose. L’impératif « lève-toi » précède le projet de leur vie future : « tu seras ma femme et nous prendrons racine » (l. 23). Il compare les deux jeunes gens à des arbres. Il célèbre ainsi l’amour terrestre qu’il oppose à l’amour céleste cher à Camille. La jeunesse de Rosette, le couple et le décor promettent du fruit. Le champ lexical de la vie avec « sève », « moisson », etc. fait penser aux futurs enfants du couple qui se forme.
La mise en scène de Perdican fait ressembler les jeunes amants à Adam et Eve dans la Genèse. Le but est de rendre Camille jalouse, de lui faire du mal par les mots. La parole qu’il donne à Rosette a une valeur contestable car il semble lui promettre de l’épouser sans avoir l’intention réelle de le faire. Il joue avec le cœur des deux femmes et ne soupçonne pas que son cœur puisse en souffrir.
Conclusion :
Musset idéalise l’amour comme beaucoup d’auteurs Romantiques. Or, il le rend ainsi inaccessible et semble donc toujours déçu. Il met en scène cet impossible amour dans sa pièce en utilisant un triangle amoureux où le mensonge domine et la vérité tue, prenant le contre-pied de Marivaux dans les Fausses Confidences où le mensonge avoué est aussitôt pardonné, laissant place au bonheur et au mariage.